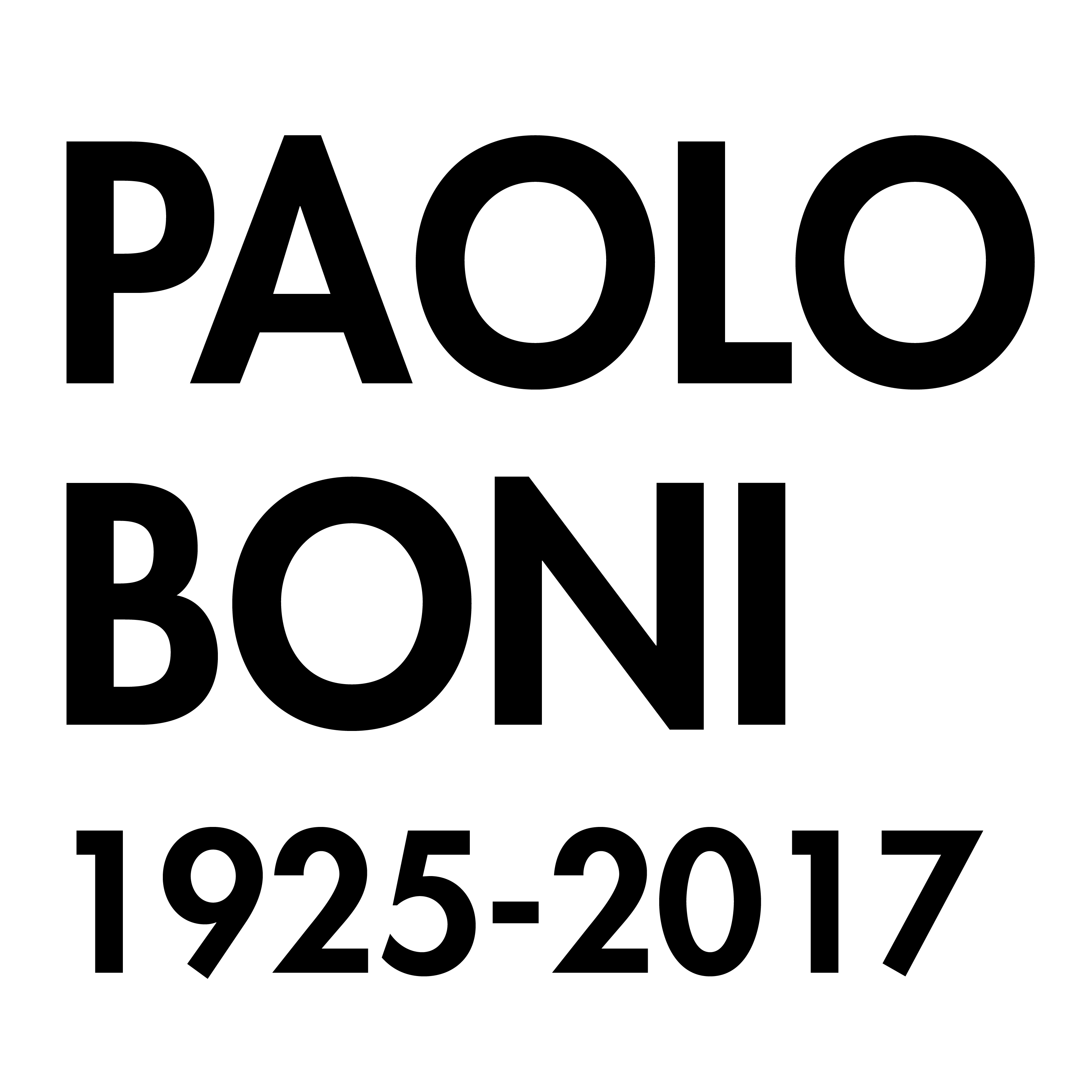Paolo Boni dans son atelier impasse du Rouet à Paris © Cuchi White
Giorgio Agnisola
paule gauthier
michelangelo masciotta
georges perec
Vanessa Noizet
par Giorgio Agnisola
LE FANTASTIQUE ET LE MÉCANIQUE
Paolo Boni possède une vocation innée pour l’abstraction ou plus précisément pour la construction abstraite, impliquant aussi les limites d’une expression manuelle, d’une mécanique des rapports et des assemblages, repris et dominés à la dimension de l’espace poétique et imaginaire.
L’art de Boni nous semble marqué par une double attitude, par une présence conjointe, précisément, de la poésie et de la mécanique, de projets réfléchis et de poussées impulsives, d’une articulation formelle et lucide, d’un sursaut émotif d’images.
Une attitude qui nous renvoie à la leçon cubiste et constructiviste (surtout des maîtres russes et de Magnelli) sans ignorer les plus célèbres témoignages surréalistes et métaphysiques, mais qui possède une marque incontestablement personnelle (au-delà de la singularité des procédés techniques qui caractérisent son œuvre) un style que l’on pourrait définir comme romantique par certains aspects méditerranéens, au travers la rigueur des acquisitions structurales et des compositions bien maîtrisées.
Le fait que l’expression de Boni soit authentiquement enracinée dans une expérience personnelle est d’ailleurs confirmé par les aspects artisanaux impliqués dans son art.
Giorgio Agnisola, Extrait du texte du livre Paolo Boni Il Fantastico e la Mecanica. Texte traduit de l’italien.
par Paule Gauthier
On a écrit à propos du sens des œuvres de Boni qu’il avait été frappé par les paysages accidentés de sa province natale, en somme par le caractère physique du milieu. Il faut y voir une forme plus universelle, car, chez lui, sentiments et ambiance relèvent d’une même source.
S’il réduit la vie au sens tactile et visuel des choses, dans cette alternance il juxtapose le cours du temps et l’aspect de l’être. Les aspérités et les violences s’estompent en mélodie, ou bien importent la véhémence de courants contraires. Pourtant, si l’on considère l’ensemble des œuvres, c’est le côté équilibré qui s’impose.
Paule Gauthier, Extrait de la revue Cimaise
par Michelangelo Masciotta
Boni, a trouvé des solutions originales dans toutes les disciplines qu’il pratique : peintures, sculpture, gravure, ou, à la confluence de divers arts, lorsqu’il élabore cette forme bien personnelle d’expression que sont ses bas-reliefs métalliques.
Peintre, il a remplacé par des modulations subtiles les oppositions violentes ; il a su trouver, pour les substituer aux simples liens formels, des rapports profonds et intimes.
Sculpteur, il s’est fait confident de la nature sans pour autant se laisser prendre à l’anthropomorphisme ni s’assujettir à un respect extérieur des apparences. Il s‘agit, au vrai, d’une nature plus secrète, qui ne s’avoue pas au premier regard mais se manifeste, en une poussée venue de l’extérieur – ou en deçà des formes et des objets visibles, à la pointe de la hardiesse plastique.
Graveur, il creuse les planches jusqu’à les percer, l’épreuve étant soumise à une pression si forte qu’elle risque d’être écrasée. Il obtient ainsi sur le papier, des hauts reliefs et des creux profonds entre lesquels les signes courent comme portés par des eaux de ravines qui dévalent et qui vaquent, rapides, au pied des monts.
Son monde est, aujourd’hui, le monde de l’imprévu : états d’âme, durée intérieure, réminiscences, fantasmes et mirages de la solitude, transpositions des lumières, équivalences ou contrastes des sentiments, réductions ou élargissements de l’espace, rythme des pleins et des vides, tels sont maintenant les thèmes selon lesquels s’ordonne et se renouvelle son travail.
Michelangelo Masciotta, Extrait d’une présentation d’exposition
par Georges Perec
PAOLO BONI, LE MÉCANICIEN DE L’IMAGINAIRE
La première sensation que l’on éprouve lorsque l’on regarde le travail de Paolo Boni est celle d’un combat : combat entre le peintre et sa peinture, combat contre la matière, contre les formes, combat contre l’espace initial du tableau, son cadre même, ce châssis de bois tendu de toile dont, à première vue, on pourrait croire qu’il sera incapable de contenir l’énergie qui s’y est emmagasinée, comme si le peintre avait tenté d’y comprimer un instant des forces, des tensions dont le rassemblement semble devoir provoquer tôt ou tard une déflagration…
L’agencement de ces éléments de base incessamment repris d’une toile à l’autre, leur superposition, leur désarticulation, leur jeu, produit ces étranges trompe-l’œil qu’on dirait élaborés par un mécanicien de l’imaginaire qui irait chercher au fond des forges, des fonderies et des ateliers la matière même de ses rêves.
Georges Perec, Extrait de présentation à la Fiac
par Vanessa Noizet
LES ESPACES IMAGINAIRES. FRAGMENTS POUR PAOLO BONI
« Je ne vois pas de meilleur hommage à lui rendre, maintenant que son œuvre est venue à son terme, que de refuser l’idée d’un point final pour voir dans l’entreprise qui fut la sienne, et jusque dans ses toutes dernières productions, un perpétuel départ, quelque chose comme une entrée en matière sans cesse renouvelée […]. »1
L’écriture, à l’égal de la peinture, de la sculpture et de la gravure, bien avant d’apparaître aux yeux de l’auteur, du lecteur ou du spectateur sous la forme de l’objet fini, de l’œuvre achevée circonscrite aux limites de la page, de la toile, de la plaque de métal, du bloc de pierre ou de bois, manifeste avant toute chose une pensée en acte, agissante et opérante, qu’il appartient au commentateur de percevoir et d’expliciter afin de « trouver “l’entrée” »2. En ce qui concerne Paolo Boni, peintre né en 1925 près de Florence et installé en France à partir de 1954, celle-ci reste avant toute chose à chercher et à découvrir tant le travail de l’artiste est jusqu’à présent demeuré peu ou prou confidentiel.
Cette dernière affirmation n’est pourtant pas dénuée de paradoxes, ni d’ambiguïtés. D’une part parce que Paolo Boni n’a jamais cessé d’exposer jusque dans les années 1990, de façon personnelle et collective, en Europe et aux États-Unis (les lecteurs et lectrices intéressés trouveront les noms et les dates de certaines de ces manifestations dans les catalogues publiés à ces occasions). D’autre part car son art a très tôt été remarqué par des artistes, des écrivains, des historiens, des critiques et des conservateurs de musées, qui ont tous relevé sa singularité au regard d’une « École de Paris » finissante et d’une scène artistique française particulièrement divisée.
Le peintre Gino Severini, membre du groupe futuriste dans les années 1910, a ainsi rédigé une préface à l’occasion de la première exposition parisienne de Paolo Boni en 1954, organisée à la galerie Voyelle. Herta Wescher et Richard S. Field, auteurs respectifs d’ouvrages de référence sur le collage et la gravure, ont aussi valorisé les productions de Boni dans de beaux articles, de même que les critiques Simone Frigerio et Jacques Lepage, lesquels ont régulièrement contribué à quelques-unes des plus importantes revues françaises pendant la période de la Guerre froide : Art et Architecture d’aujourd’hui, Les Lettres françaises, etc. Les écrivains Michel Butor, Maurice Roche et Georges Perec, proches de Paolo Boni, ont collaboré avec l’artiste à l’élaboration de recueils d’estampes où se mêlent habilement les textes et les images à l’exemple de Chronique des Astéroïdes, de Ça ! ou de Métaux, sur les cent-trente-cinq tirages prévus seuls quelques exemplaires ont été imprimés en 1985.
Quoiqu’elle révèle les cercles amicaux et professionnels de l’artiste et renseigne sur les diffusions contemporaines de son travail, cette succincte recension de la fortune critique de Paolo Boni ne saurait en aucune façon occulter l’œuvre, riche et conséquente. C’est la raison pour laquelle de nombreux textes accentuent son caractère véritablement indépendant et original, fondé sur les recherches picturales et sculpturales initiées par Paolo Boni dans les années 40 et prolongées peu de temps après au travers d’expériences gravées inventives, baptisées « graphisculptures »3 par Alfonso Ciranna en 1970.
À rebours des techniques de gravure traditionnelles, Paolo Boni ne procède pas par retraits successifs de matière. Loin de recourir à une quelconque soustraction, incision au burin ou morsure à l’acide, Boni façonne davantage le métal par ajouts : ceux de « morceaux de métal découpés », « rivés » sur la matrice originelle.4 Suite aux premiers portraits et paysages peints, loués en leur temps par Gino Severini, qui y décèle l’influence conjuguée des peintres « modernes » français et des primitifs italiens – faut-il rappeler que le village natal de Paolo Boni, Vicchio di Mugello, est le pays natal de Giotto di Bondone, ses productions matérialisent les préoccupations essentiellement formelles de l’artiste, nourries de la pratique simultanée de ces différents arts.
À l’intar de ses essais sculpturaux et graphiques, où dominent le goût de Paolo Boni pour les surfaces planes et les reliefs, ses peintures réalisées à partir des années 60 gagnent peu à peu en précision. Les juxtapositions et les superpositions de formes y sont dorénavant privilégiées ; les aplats et les contours nets préférés à la touche et aux empâtements ostensibles, sans que la matérialité des œuvres ne soit aucunement niée. Tandis que ses premières toiles sont inspirées par les trouvailles des peintres dits fauves et cubistes et qu’elles représentent des motifs aux volumes fortement géométrisés, les suivantes semblent plutôt témoigner de l’intérêt manifesté par Paolo Boni pour l’œuvre de Fernand Léger, ses contrastes de formes et sa grande plasticité.
Contrairement à l’art de ce dernier, lequel accuse une fascination certaine pour le monde industriel, quitte à ce que les particularités des corps humains, des objets et des machines s’entremêlent, celui de Boni suggère davantage la prédilection de l’inventeur des gravures-reliefs pour l’espace cosmique et les avions; les rêves et les utopies qu’ils charrient; les champs qu’ils ouvrent à l’imagination. L’œuvre de Paolo Boni, tel qu’il nous apparaît aujourd’hui, quelques mois après la disparition de l’artiste, est en lui-même un univers personnel, échappant aux querelles artistiques contemporaines et aux « angoissants problèmes du figuratif et du non figuratif, de l’art abstrait géométrique ou non, ou de l’art tachiste […] »5. Ni abstrait, ni figuratif, parce qu’il est justement l’un et l’autre, son art partiellement dévoilé subsiste, alors que Paolo Boni a fui dans les espaces imaginaires.